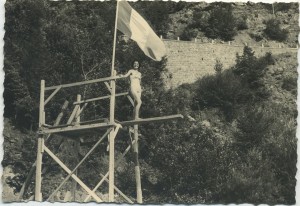Ou comment le titre d’un petit dessin de Michaël Borremans me donne l’idée de vous parler d’un auteur dont je viens de me rappeler.
On m’a souvent demandé d’où me venait ce plaisir de raconter des histoire…
A cause de Jerome K. Jerome en partie…
Bonhomme à la cheville duquel je voudrais arriver un jour,
tout comme à celle d’Alphonse Allais
ou d’Ava Gardner (mais je m’égare…)
Plutôt que « le tableau de l’oncle Podger »
je poste ici un autre petit extrait, qui,
à l’époque où je le découvris,
(je devais avoir quinze-seize ans par là)
me fit rire tout seul pendant quatre ou cinq pages…
Vous savez, ces moments de rire qui vous prennent et ne vous lâchent plus
à fur et à mesure que « l’histoire part en sucette »…
Où l’on tourne la page tout à son plaisir,
ces moments de lecture qui demeurent magiques parce que si bien racontés.

Pour le petit déjeuner, George suggéra, entre autres, des œufs et du lard, qui sont faciles à cuire, de la viande froide, du thé, du pain, du beurre, de la confiture, mais aucun fromage. Le fromage, comme le pétrole, manque totalement de discrétion. Il envahit tout le bateau, se répand dans le garde-manger et « fromageodorise » tout ce qui s’y trouve. Impossible alors de différencier le goût de la tarte aux pommes de celui de la saucisse de Francfort ou des fraises à la crème. Tout vous semble fromage. En un mot, le bougre est carrément envahissant.
Un de mes amis acheta un jour une paire de fromages à Liverpool. De merveilleux fromages, moelleux et bien faits, d’un fumet d’une puissance de deux cents chevaux-vapeur, et qu’on aurait pu garantir capable de porter à trois milles et de foudroyer son homme à deux cents mètres. Je me trouvais alors à Liverpool, et mon ami me demanda si cela ne me dérangerait pas de les emporter avec moi à Londres, car lui-même ne rentrerait pas avant un jour ou deux, et il ne présumait pas que ces fromages eussent une espérance de vie beaucoup plus longue.
« Mais, avec plaisir, cher ami, lui répondis-je. Avec plaisir. »
J’allai chercher les fromages, puis je pris un fiacre pour me rendre à la gare. C’était une vieille guimbarde, tirée par une vieille carne somnambule, cagneuse et poussive, que son propriétaire, dans le feu de la conversation, qualifia par mégarde de cheval. Je posai les fromages sur l’impériale, et nous partîmes à une allure qui eût rendu hommage au plus rapide des rouleaux compresseurs construits jusqu’à ce jour ; et tout alla d’abord aussi gaiement qu’un glas d’enterrement, jusqu’à ce que nous eûmes tourné le coin. Là, le vent apporta une bouffée fromagère en plein sur notre pégase. La rosse se réveilla net, poussa un hennissement d’effroi, et s’élança à cinq kilomètres à l’heure. Le vent continua de souffler dans sa direction, et nous n’avions pas atteint le bout de la rue, que nous filions à près de sept à l’heure, laissant sur place infirmes et grosses vieilles dames.
Deux porteurs, plus le cocher, ne furent pas de trop pour maîtriser l’animal, à l’arrivée en gare ; je doute même qu’ils y fussent parvenus, si l’un des hommes n’avait eu la présence d’esprit de lui plaquer son mouchoir sur les naseaux, et de brûler du papier d’Arménie.
Je pris mon billet, et gagnai avec mes fromages le quai d’un pas royal ; les gens s’écartaient respectueusement à mon passage. Le train était bondé, et je dus monter dans un compartiment où s’entassaient déjà sept personnes. Un vieux monsieur grincheux protesta. Je l’ignorai, déposai mes fromages dans le filet, puis me fis une place non sans le gratifier d’un gracieux sourire, et déclarer que nous avions une chaude journée. Quelques minutes passèrent, et le vieux monsieur commença à se tortiller.
« Ça sent le renfermé, ici, dit-il.
– Vraiment étouffant », ajouta son voisin.
Et tous deux de se mettre à renifler. Au troisième reniflement, la respiration coupée, ils se levèrent sans un mot et sortirent. Puis une grosse dame se leva à son tour et affirma bien fort qu’il était honteux de manquer ainsi de respect à une honnête mère de famille. Ramassant son sac et ses huit paquets, elle sortit à son tour. Les quatre voyageurs restants gardèrent un air stoïque jusqu’au moment où un personnage à l’air solennel, assis dans un coin, et qui, d’après son costume et son aspect général, semblait appartenir à la corporation des pompes funèbres, dit que l’odeur lui rappelait celle des macchabées. Sur quoi, les trois autres voyageurs bondirent en même temps vers la portière, se bousculant à qui mieux mieux.
Je souris au funèbre personnage, et lui dis que, vraisemblablement, nous aurions le compartiment pour nous seuls. Il eut un rire aimable et me répondit que certaines personnes faisaient bien des chichis pour peu de chose. Mais son expression se décomposa curieusement en cours de route, et, quand nous arrivâmes à Crewe, il me parut si déprimé que je l’invitai à venir prendre un verre. Il accepta, et nous nous frayâmes un chemin jusqu’au buffet, où nous criâmes, tambourinâmes et fîmes de grands signes avec nos parapluies pendant un quart d’heure. Finalement, une jeune femme arriva et nous demanda si nous désirions quelque chose.
« Que prendrez-vous ? demandai-je à mon compagnon.
– Une triple dose de cognac, mademoiselle, et du sec, s’il vous plaît ! »
Il vida son verre et s’éloigna tranquillement pour monter dans une autre voiture, ce que j’estimai de la dernière grossièreté.
À partir de Crewe, le train avait beau être bondé, j’eus le compartiment pour moi seul. À chaque arrêt en gare, les gens, à la vue de tant d’espace inoccupé, se précipitaient. « Par là, Maria. Viens vite, il y a plein de places ! » « Hé, Tom ! installons-nous ici ! » Et tous accouraient, chargés de lourdes valises, se bousculant pour monter les premiers. Quelqu’un ouvrait la portière, escaladait le marchepied… pour tituber et retomber incontinent en arrière dans les bras de celui qui le suivait. Tous se risquèrent, respirèrent et prirent la fuite avant de se bousculer de nouveau dans d’autres voitures ou payer la différence et monter en première.
Je descendis en gare d’Euston et portai les fromages chez mon ami. Quand sa femme entra dans la pièce, elle s’immobilisa, humant l’air. Puis elle me demanda : « Qu’est-ce que c’est ? Ne me cachez rien, même le pire.
– Ce sont les fromages, répondis-je. Tom les a achetés à Liverpool, et m’a prié de les rapporter chez vous. »
J’ajoutai que j’espérais bien qu’elle comprenait que je n’étais pas responsable de cet achat. Elle m’assura qu’elle ne l’ignorait pas, mais qu’elle aurait une conversation sérieuse avec Tom à son retour.
Mon ami fut retenu à Liverpool plus longtemps qu’il ne l’avait prévu. Trois jours plus tard, il n’était pas encore rentré, et sa femme vint me rendre visite.
« Que vous a dit Tom au sujet des fromages ? » me demanda-t-elle.
Je répondis qu’il avait recommandé de les tenir en lieu frais et que personne ne devait y toucher.
« Personne ne risque de les toucher, dit-elle. Il ne les a donc pas sentis ? »
J’étais persuadé du contraire, et j’ajoutai qu’il paraissait tenir beaucoup à ces fromages.
« Croyez-vous qu’il serait très contrarié si je payais quelqu’un pour m’en débarrasser et aller les enterrer quelque part ? »
Je lui répondis qu’il en perdrait à jamais son sourire.
Une idée lui vint. « Cela vous gênerait-il de les lui garder ? me demanda-t-elle. Je les ferais porter chez vous.
– Madame, répliquai-je, l’odeur du fromage ne me déplaît pas, et je conserverai à jamais un excellent souvenir du voyage que j’ai fait l’autre jour en leur compagnie depuis Liverpool, mais, voyez-vous, dans ce monde, il ne faut pas oublier ses semblables. La dame qui me fait l’honneur de m’accueillir sous son toit est veuve, et, autant que je sache, peut-être même orpheline. Elle a une manière forte, et j’ajouterai éloquente, de s’opposer, comme elle dit, à ce qu’on « se moque d’elle ». Or, la présence de ces fromages dans sa maison lui donnerait précisément l’impression, j’en suis persuadé, qu’on « se moque d’elle ». Et il ne sera pas dit que je me serai moqué de la veuve et de l’orpheline.
– Eh bien, dans ce cas, dit la femme de mon ami, se levant, je n’ai plus qu’à emmener les enfants à l’hôtel et attendre que ces fromages soient mangés. Je me refuse à vivre plus longtemps sous le même toit qu’eux. »
Elle tint parole, laissant la maison aux soins de la femme de ménage, laquelle, lorsqu’on lui demanda si l’odeur ne l’importunait pas trop, répondit, ingénue : « Quelle odeur ? » Invitée peu après à mettre le nez sur la chose et à renifler fort, elle déclara qu’elle percevait à présent « comme un léger parfum de melon ! ». D’où l’on conclut qu’elle ne courait aucun risque notable à vivre dans la sus-décrite atmosphère. On l’y laissa donc sans regret.
La note de l’hôtel s’éleva à quinze guinées ; et mon ami, calculs faits, constata que les fromages lui avaient coûté huit guinées la livre. Il ajouta qu’il était très friand de fromage, mais qu’un tel penchant dépassait par trop ses moyens, et il décida par conséquent de s’en débarrasser. Il les jeta dans le canal, mais dut les repêcher, à la suite des plaintes des riverains, qui prétendirent éprouver des faiblesses. Après quoi, il les abandonna par une nuit noire dans le cimetière de la paroisse. Mais le fossoyeur les découvrit, et cria au scandale, prétendant qu’on avait voulu lui enlever son gagne-pain en réveillant les morts.
Mon ami s’en débarrassa enfin en les emportant jusqu’à une station balnéaire, où il les enterra sur la plage. Le lieu en acquit une grande réputation.
Les touristes disaient qu’ils n’avaient encore jamais remarqué combien l’air y était piquant, si bien que malades des bronches et grands anémiques y accoururent en foule pendant des années. En dépit de mon goût pour le fromage, j’approuvai donc la décision de George de ne pas en emporter à bord.
« Nous nous passerons du thé de cinq heures, continua George (à ces mots, la figure de Harris s’allongea), mais nous prendrons à sept heures un bon petit repas qui tiendra à la fois lieu de dîner, de thé et de souper. »
…
(Jerome K. Jerome
TROIS HOMMES DANS UN BATEAU
Sans oublier le chien !
(1889).